
Pierre Cloutier
Membre de l’équipe de vidéastes de l’Association humaniste du Québec. Il a assuré l’organisation et la transcription de diverses conférences et produit nombre de vidéos de l’Association. Il a également contribué à la revue. Il est membre du Conseil national du Mouvement laïque québécois. Pierre a piloté pendant vingt ans la fonction de traduction dans une multinationale oeuvrant dans la gestion des ressources humaines. Membre agréé de l’OTTIAQ, à la retraite depuis dix ans, il est aujourd’hui traducteur indépendant.
Del Busso, éditeur, Montréal (Québec) 2010, 223 pages
L’analyse de cet ouvrage par Pierre Cloutier, membre du MLQ, tombe à point nommé. Je lui laisse la plume :

Une époque révolue, un autre monde
Lorsqu’on parcourt ces pages avec le bénéfice du recul, on est frappé par le style allégorique, puisant à la mythologie d’une fermeté toute maternelle, avec lequel l’autorité ecclésiastique réclamait la prééminence intellectuelle et morale qu’elle considérait comme un droit acquis et de nature, tandis qu’elle traitait avec les gouvernements élus de chancellerie à chancellerie. Faut-il se surprendre que Paul Claudel ait qualifié le Québec de Tibet du Catholicisme ?
Le fait est que l’inextricable contradiction dans laquelle notre société s’était enferrée en optant pour une école catholique romaine et publique, d’une part, privée de l’autre, les deux secteurs étant sous la férule de son clergé, avait braqué pendant deux siècles le Québec à contresens de l’histoire contemporaine.
Cette école cléricale a été tout entière conçue et régie par l’autorité ecclésiastique dont l’État québécois n’était devenu que l’exécutant depuis qu’elle avait réclamé et obtenu l’abolition du ministère de l’Instruction publiquesurvenue en 1875. Pour mieux 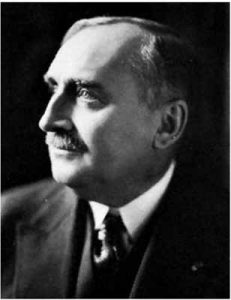
L’école ascenseur social
Elle refusait de jouer son rôle d’ascenseur social, car cette école cléricale était à deux voies : l’une roturière, l’autre noble.
Voie roturière

Voie noble
Aux fils de famille, le collège classique proposait, à grands frais, un cursus de huit ans. Celui-ci mettait de l’avant une conception des humanités classiques qui accusait un bon siècle de retard, le programme alliant philosophie thomiste, déclinaisons latines
Fernand Séguin, brillant pionnier de la vulgarisation scientifique et de l’éducation populaire, rappelait les thèses de chimie portant sur le taux d’alcoolémie des vins de messe et la viscosité des saints-chrêmes
Tout au long des années 50, Duplessis, outré, refusera les subventions fédérales aux universités considérées comme une intrusion dans son trécarré (*) national. Cela ne bonifiera ni la qualité, ni la disponibilité de l’enseignement universitaire québécois dispensé dans ces institutions qui, en revanche, sont dotées d’une charte papale, Leur haute direction est donc réservée à des clercs qui, à tous les niveaux, ont mis le Québec en coupe réglée. L’Université de Montréal n’aura son premier recteur laïc, Roger Gaudry, qu’en 1965.
Dans le secteur anglais, au Québec comme partout ailleurs en Amérique du Nord, le high school public ouvrait aux candidats méritants, dès 17 ans, l’accès à l’université où un cursus de quatre ans menait au baccalauréat. Faute d’être gratuite, cette formation de premier cycle n’était pas, à tout le moins, volontairement mise hors de portée des diplômés du secteur public par un plafond de verre.
L’agriculture ? Créé en 1905, ouvert en 1907, Macdonald College proposait une formation en sciences de l’agriculture et de l’environnement. Ainsi, les talents de chacun pouvaient-ils s’épanouir au bénéfice de tous dans une société normalement conçue où aucune instance n’aurait même rêvé d’interdire, d’autorité, au plus grand nombre de ceux qui n’étaient pas favorisés par la naissance ou la fortune, l’accès à des études universitaires leur permettant d’acquérir tout à la fois l’autonomie de jugement et la fonctionnalité économique, qualités citoyennes, à hauteur de leurs capacités intellectuelles et de leur industrie.
On ne peut qu’emprunter les mots de Condorcet pour décrire cet idéal éducatif qui était, de fait, celui de l’Amérique, première nation révolutionnaire du siècle des Lumières :

L’école gestionnaire de la mixité
L’école cléricale québécoise a aussi trahi sa mission de gestionnaire de la mixité, dans un continent d’immigration. Catholique d’abord, elle refoulait vers le secteur protestant quiconque ne pouvait satisfaire à ce critère confessionnel, tandis que le droit canon (article 1374) interdisait aux catholiques la fréquentation d’écoles non confessionnelles ou d’autres confessions.
Ce contingentement sectaire était conçu pour entretenir le fonds de commerce démographique et économique de l’Église, – les communautés religieuses ont joui pendant un siècle d’un monopole sur la production et la vente de manuels scolaires jusqu’en 1963. Il a éloigné et exclu de la majorité québécoise francophone les aptitudes, les initiatives, la créativité, le dynamisme, dont était riche une immigration venue des quatre coins du monde, qui avait fait toute l’originalité bouillonnante, tout le génie créateur de l’Amérique. Résultat de cette stratégie scolaire défensive et à courte vue : les vagues successives d’immigration accueillies par le secteur protestant anglophone constitueraient éventuellement les Québécois francophones en minorité sur leur sol, à leur initiative et à leurs frais.
La révolution des esprits requise pour normaliser la situation et faire en sorte qu’une majorité québécoise francophone intègre naturellement les immigrants dans ses institutions scolaires d’État, sans distinction d’origine ou de croyance, est désormais accomplie dans les structures, si elle ne l’est pas toujours dans les mœurs. Il nous reste encore à mieux apprendre comment gérer l’agitation corpusculaire d’un milieu multiethnique et multiconfessionnel auquel seule la laïcité principielle de l’État peut assurer un cadre égalitaire pour mettre de l’avant des valeurs universelles auxquelles tous et toutes peuvent souscrire. Retenons qu’au-delà de l’intégration scolaire, la clé de cette problématique est d’assurer l’intégration professionnelle et économique de diplômés d’origines multiples. Partie qui, même aujourd’hui, n’est pas encore gagnée.
Une révolution des structures, des esprits et des cœurs

Bizarrerie d’époque, la crainte, de fait la terreur de l’État porte à agiter l’épouvantail de la dictature dès que quiconque ose remettre en question un système confinant à un apartheid théocratique. L’argument ad hominem, le procès d’intention dont les réactionnaires usent et abusent, évite à ceux qui le brandissent de fonder leur raisonnement en principe pour camper l’adversaire sous les traits d’un sociopathe immoraliste, prêt à trahir… le Christ et Dieu lui-même, qui d’autre.
Avril 1963, première version du Bill 60. François Albert-Angers, irrédentiste, dénonce l’intervention de l’État. Il craint que le tout soit passé « à la vapeur ». Il estimera Laurendeau, porte-parole du camp adverse, « fanatisé », « cassant », « dictatorial ». Le ton est donné.
À lire certaines critiques, dont Angers sans doute, « on a le sentiment », écrit l’éditorialiste, que l’éducation est livrée à un dictateur, alors que le Québec « a soixante ans de retard sur la majorité des démocraties occidentales ». (p. 100)
Dictateur, mot clé de l’imaginaire conservateur. Cet antiétatisme n’est pas exclusif au parti des dévots. Il est l’épouvantail d’office de quiconque veut démoniser le pouvoir de l’État Québécois, toujours suspect d’un totalitarisme de carnaval. Judy Lamarsh poussera l’extravagance inventive jusqu’à prétendre, en 1963, que la Caisse de dépôt et de placement du gouvernement du Québec, constituerait une concentration de pouvoir financier « national socialiste » comparable à la montée en puissance de l’Allemagne nazie. Sieg Heil !
Au lendemain de la création du Mouvement laïque de langue française (MLF), (1962), défenseur de l’éducation universelle et obligatoire, soit d’État, la Société Saint-Jean Baptiste dénoncera le mouvement comme inspiré d’une « idéologie totalitaire », tandis 
Faire peser sur la social démocratie laïque un soupçon de totalitarisme pour lui imputer ce motif indigne, cet agenda caché, voilà le coup de revers des pouvoirs ecclésiastiques en place qui, par ailleurs, se présentent comme étant de nature et dans l’ordre des choses, providentiels puisque d’institution divine.

Parmi les interventions marquantes à l’orée des années soixante, retenons celle de Maurice Blain :
Blain pourfend le « mythe du totalitarisme de l’État laïque »
Devant le fait religieux, l’État laïque « doit être le plus ouvert, le plus tolérant, le moins confessionnel, c’est-à-dire le plus libre et le plus souverain ». Sa « neutralité active » est le signe d’une « expression démocratique d’une volonté de justice » et dans « cette vocation, l’État affirme que l’unité de la nation repose sur un autre fondement que l’unité de la foi. Blain met le doigt sur une question débattue depuis les années 1930 : dissocier la religion et la nationalité, mettre un terme à la synonymie de catholique et de Canadien français. Ce n’est pas la foi qui peut et doit définir une nation et, de surcroît, pas une seule foi. Le contrat social de la laïcité devient une « règle de justice politique » qui fonde « le droit de tous les citoyens, sans distinction, de participer à toutes les formes de vie sociale, d’exercer les mêmes droits, de partager les mêmes obligations ». Enfin, au contraire du mythe de la division induite par la laïcité, Blain présente celle-ci comme « condition de paix sociale », comme valeur capable d’assurer un équilibre : « L’unité de la nation que la fonction d’arbitrage de l’État devra sans cesse construire. » La laïcité doit être conçue comme un effort de synthèse des valeurs communes à toutes les pensées, partageant certaines conceptions fondamentales de la personne, de la société, de la liberté » Cette position n’est pas sans faire penser à l’idée plus contemporaine de culture civique commune. (p. 78)
Malgré la modernité de ton, Blain et le MLF optent pour ce que l’on appelle alors la solution Lacoste, soit la mise en place de triples instances scolaires : catholique, protestante et neutre, tant francophone qu’anglophone, plutôt que d’affirmer la laïcité intégrale de l’éducation nationale dont l’universalité en simplifierait infiniment la gestion. C’est que
l’incontournable article 93 de la constitution de 1867, qui protège l’éducation catholique et protestante dans l’esprit de l’époque, interdit pareille laïcisation. Il ne sera abrogé qu’en 1997 par le gouvernement Bouchard.
On imagine l’imbroglio administratif et les souques à corde budgétaires et syndicaux qu’entraînerait ce multiple contingentement auquel André Laurendeau ne trouvait « rien de déraisonnable ou d’offensant », puisqu’il sauvegarde la chasse gardée catholique et perpétue le chacun chez soi en parachevant l’apartheid scolaire par l’ajout d’un secteur neutre étanche et clos.
Parc aux cerfs réservé, l’éducation québécoise francophone se présente comme un marché fermé et comporte les inconvénients d’un monopole. Au service de quels privilèges ? Dans les collèges classiques, les cléricaux avaient pratiqué une discrimination professionnelle de tradition, au détriment de quiconque n’était pas clerc, refusant des postes de responsabilité aux laïcs. (p.91) ce qui est loin de valoriser la profession et y aggrave d’autant la pénurie de compétences quand vient le moment de nationaliser le tout. Par ailleurs, le statut de clerc conférait traditionnellement aux gens d’Église une qualification professionnelle présumée, comme enseignant, dont la reconnaissance hors Québec n’allait pas de soi. L’exigence de voir reconnues ces qualifications de complaisance allait compliquer d’autant l’implantation d’écoles françaises dans la diaspora canadienne et confirmer la frilosité identitaire des francophones, tout en amenant les clercs à camper avantageusement le rôle de défenseur de la nation.
Et alors vint la Commission Parent

Surprise, à mi-chemin du vingtième siècle, on voit ce débat mené devant le tribunal de l’opinion selon des concepts dérivés d’un vocabulaire théologique. Le sacré et le profane, Dieu et César, le droit à la « vérité » et le droit à « l’erreur » l’une et l’autre essentialisées, considérées absolument.
Ces catégories qui conceptualisent la chose publique au regard de l’éternité semblent pour certains plus tangibles que l’intérêt général, la souveraineté populaire et le droit à la liberté de conscience. Mais surtout, reprenons la magnifique formulation de Condorcet, elles font abstraction de la responsabilité incombant à l’État de développer toute l’étendue des talents de chacun, qui sont constitutifs de son humanité quels que soient son origine ou ses croyances, et par là, d’établir entre tous les citoyens québécois « une égalité de fait et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi ».
Cette équation évidente entre émancipation intellectuelle, autonomie de jugement, éducation civique à la liberté donc à la responsabilité individuelle, qualification professionnelle, promotion économique, égalité citoyenne et prospérité générale fait figure de point aveugle des autorités traditionnelles en ce début des années 60. C’est qu’elle fait primer l’individuel sur le collectif dans une société habituée à l’inverse, tout en proposant une réussite forgée selon les règles d’une méritocratie, plutôt que l’idéal de vie convenu d’un salut par le renoncement, dont l’abolition de soi est conduite sous la main ferme d’une instance hiérarchique. Ceux qui au MLF prennent le contrepied des idées reçues se font qualifier de doctrinaires et d’idéologues. D’étrangers de l’intérieur dont les intentions réelles sont suspectes, car n’étant pas gens de foi, ils ne peuvent être que de mauvaise foi.
Autre étonnement : constater que l’assemblée des évêques, instance hiérarchique non élue, traite avec l’État québécois d’égal à égal, pour réclamer un droit de gestion du quart des fonds publics, soit la part consacrée à l’Éducation nationale, comme le souligne André Laurendeau. Plus : elle vise à imposer le recours à la confession de foi comme critère de recrutement de la structure de commandement et de contrôle des instances éducatives d’État-mais-confessionnelles, ainsi que du personnel enseignant appelé à œuvrer dans les établissements. Et pour mieux cimenter cet amalgame ecclésiastico-étatique, chacun épilogue sur ce qu’est non seulement une éducation chrétienne, mais vraiment, intégralement, authentiquement, intimement chrétienne, tant et si bien que le billet de confession pourrait faire office de certificat d’allégeance civique, sinon de qualification professionnelle.
Paul Gérin Lajoie donnera l’heure juste en faisant pendant un an le tour de la province pour défendre la remise à niveau et l’étatisation de l’éducation au Québec. La loi est finalement votée en février 1964 et entre en vigueur le 13 mai. La version finale crée un ministère de l’Éducation, biffe l’école non confessionnelle et maintient la biconfessionnalité structurelle de l’éducation nationale.
Une autorité unique et responsable… pas vraiment
La gauche laïque avait souligné le paradoxe d’une école tout à la fois confessionnelle et publique. Dans Cité Libre, Maurice Blain a réagi aux amendements des évêques qui revendiquent la mise en place d’instances sous-ministérielles confessionnelles sous l’égide de l’État.
Saluant d’abord le premier tome du Rapport Parent comme un document « désormais capital dans notre histoire » et le bill 60 comme « un acte de courage et de sagesse politiques si le Québec veut se doter d’institutions scolaires modernes », il n’y voit pas moins trois domaines où le projet de loi paraît insuffisant : « la souveraineté absolue de la juridiction civile ou politique (de l’État) dans les pouvoir de décision et de coordination »; la laïcité de ses organismes supérieurs dans le gouvernement du système scolaire, pour affranchir ses rapports avec le pouvoir des Églises »; la volonté d’instaurer un régime scolaire qui demeure ouvert à l’avenir (à) toute évolution sociologique, et en particulier à l’enseignement non confessionnel. (p. 107)
Amendé par les évêques, le Rapport Parent et la loi qui en découle perpétuent le repli sectaire dans le nouvel ordre des choses en soumettant la nomination des grands commis et de certains organismes à la consultation de comités confessionnels, – alors qu’ils devraient être désignés par le premier-ministre ou élus, donc responsables de leurs actes devant l’Assemblée législative et non celle des évêques. C’était, une fois de plus, réduire l’État québécois au statut de bras séculier de l’autorité ecclésiastique. L’abbé O’Neil qualifiera cette optique de médiévale.
Dans l’immédiat, « cette formule de compromis juridico-social reproduira fatalement aux niveaux des sous-ministres et des comités, le cloisonnement funeste et sécuritaire du régime du (Département de l’instruction publique) dont l’expérience de « cent ans de conservatisme et d’impuissance » devrait « commencer à nous enseigner les avantages d’une autorité unique et responsable ». (p. 108)
souligne Blain.
Après une assemblée spéciale, le MLF a épinglé la contradiction fondamentale : celle d’un ministère d’État gouvernant des écoles d’Églises. Il protestera quant à l’absence de toute disposition relative à l’école publique non confessionnelle. Il réclamera l’organisation d’une société selon des principes convenant à tous les citoyens.
Tandis que le Québec encaisse sa plus profonde mutation depuis deux siècles, le MLF se fera doubler par Parti Pris qui réclame, bien plus qu’un secteur non-confessionnel pour l’école publique : la neutralité de l’éducation nationale tout court. Comme la 
En réponse, Jacques Godbout radicalise en 1966 le message du MLF pour réitérer la conjonction entre laïcité et indépendance : « Nous sommes pour un Québec laïque, car c’est un premier pas vers un Québec libre ». Il opte pour une laïcité universelle, donc démocratique. La voie la plus certaine vers une communauté nationale « est celle de la laïcité ».
Ces enjeux sont encore chauds, irrésolus et à suivre, tandis que les accommodements religieux officialisent les replis communautaires au coup par coup et contingentent les sectarismes, troquant le vivre ensemble pour le côte à côte du multiculturalisme canadian. Entre temps, le crucifix patrimonial surplombant le président de l’Assemblée désormais nationale ouvre grand les bras à toutes les ambiguïtés du cours ECR où la libre pensée, l’héritage des Lumières et une éthique purement civique, commune à tous, sont passées à la trappe avec une merveilleuse entente.
Peines perdues ?

Malgré une théocratie ecclésiastique qui les accablait de sa vigilance avec une rigueur soviétique, mater et magistra, ils oeuvraient, eux aussi, sur le front de taille de la modernité et sont allés au charbon.
Pour la vidéo d’Yvan Lamonde dans You tube : http://www.youtube.com/watch?v=L-p697pBdAY
Pour de plus amples renseignements sur Yvan Lamonde http://litterature.mcgill.ca/public_lamonde.html
Notes
1 Le Québec a été la dernière province canadienne à adopter une législation rendant la fréquentation scolaire obligatoire. Les parents québécois n’ont été assujettis à cette obligation qu’à partir de 1943 pour les enfants âgés de six à quatorze ans 22. Au sein des autres provinces, les parents étaient tenus d’envoyer leurs enfants à l’école depuis 1910, voire depuis 1871 en Ontario qui a été la première province à légiférer en la matière 23
(…)
Par ailleurs, dans ces mêmes années, le sous-financement des établissements était tout particulièrement problématique, particulièrement en raison des relations gouvernementales conflictuelles entre Québec et Ottawa. Au nom de la défense de ses compétences exclusives, le gouvernement du Québec refusait les subventions fédérales pour l’enseignement supérieur, considérées comme une immixtion indue du gouvernement fédéral dans le domaine de l’éducation 26.De plus, le mode de financement des établissements était marqué par l’arbitraire et le clientélisme 27.
Conséquemment, au début des années 1960, antérieurement à l’intervention de l’État, les signes du retard du Québec en éducation étaient frappants. Selon le rapport Parent 28 qui s’appuie sur les données du recensement de 1961, seulement 51 % des jeunes de 20 à 24 ans avaient fait des études secondaires partielles ou complètes au Québec, contre 64 % dans l’ensemble du Canada (70 % en Ontario et 76 % en Colombie-Britannique).
——————————–
(* trécarré: Autre graphie de trait-carré. Procédé de division des terres ou plan cadastral conçu par les jésuites et exécuté par l’intendant Talon ; suivant ce procédé, les terres découpées en triangles isocèles ou scalènes sont regroupées en roue autour de l’église au centre formant un carré parfait, les établissements étant déployés en éventail.- Source « www.memoireduquebec.com »)


0 commentaires