À propos de l’humanisme
Extrait de « La Libre Pensée, Revue de Philosophie Humaniste », (1987), Volume 6, pp. 5-14.
« La véritable libération de la femme ne pourra pas se faire sans celle de l’homme. Au fond, le mouvement de la libération des femmes n’est pas uniquement féministe d’inspiration, il est aussi humaniste. Que les hommes et les femmes se regardent honnêtement et qu’ils essayent ensemble de revaloriser la société. Le défi auquel nous, femmes et hommes, avons à faire face est celui de vivre pour une révolution pacifique et non pas de mourir pour une révolution cruelle et, en définitive, illusoire » … Thérèse Casgrain, Une femme chez les hommes.
Qu’est-ce que l’humanisme ? Certain e-s le perçoivent comme une sorte d’« humanitarisme social » dont l’action se concrétise par un héroïsme humanitaire (Gandhi, Mère Theresa). D’autres définissent l’humanisme, au sens le plus rigoureux du terme, comme une philosophie issue de la science, une anthropologie réfléchie, qui a pour objet la mise en valeur de l’être humain, exclusion faite de tout ce qui l’aliène ou l’assujettit à des vérités immuables comme le dogmatisme religieux, l’immobilisme social, l’entrave au progrès scientifique. Alors, qui peut définir exactement l’humanisme ? Le Petit Robert ? Les associations humanistes ? L’Histoire ? J’ai fouillé chaque domaine à ma disposition, lu les étapes, les courants de l’aventure humaniste. Peu à peu, une esquisse s’est formée, un espace au social s’est ouvert qui légitime le passage de la théorie à la pratique. Au terme de ce processus, j’en suis venue à une vision sommaire de l’ensemble des processus qui ont généré les valeurs de notre société.
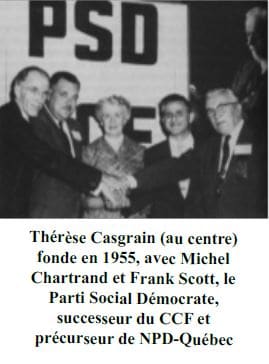
Sur un autre plan, de par son univocité, l’histoire de l’humanisme demeure, pour les femmes, une histoire de non-dits et de non-libertés. On se demande parfois par quel « miracle » nous avons pu échapper à cette autosatisfaction des idées, à ce coupage de têtes massif. Stérilisées de toutes pensées, éloignées des activités philosophiques, littéraires, scientifiques, politiques, c’est par la défense acharnée de leurs droits, de leurs idées et de leurs valeurs, que des femmes ont pu enfin prendre une part active dans la société. Ce tour de force de l’affirmation de l’autre moitié de l’humanité, conduit vers l’éclosion du féminisme. Des femmes envahissent maintenant les lieux de production du savoir et de la création. Scientifiques, philosophes, écrivaines, chercheuses, développent un nouveau champ de connaissance : l’expérience féminine. Le savoir traditionnel (basé sur l’expérience des hommes) doit dorénavant tenir compte des valeurs et de l’expérience des femmes. Nous sommes donc en présence d’une nouvelle réalité. Les femmes et les hommes ont enfin cette chance, unique dans l’histoire, de penser, de dire, le sens de « l’humanité » . Pour la première fois dans l’histoire, nous assistons à la possibilité de voir surgir un humanisme vrai, fécond et essentiel à l’évolution.
L’actualité
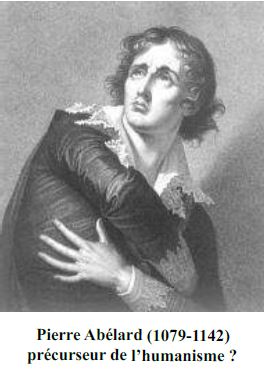
Une histoire sans fin : Vigueur… sommeil… renaissance
Ces débats qui opposent, qui scindent les humanistes, tirent leur origine d’un lointain passé. Historiquement, ce mouvement d’esprit est représenté par les « humanistes » de la Renaissance et caractérisé par un effort pour relever la dignité de l’esprit humain et le mettre en valeur. Il interpelle également la formation de l’esprit humain par la culture littéraire ou scientifique. (Petit Robert) Les époques et les courants humanistes ne font pas tranche dans l’histoire. Tel que pour l’évolution, il n’existe pas de mutation brusque ou de rupture véritable. Opposer la Renaissance aux Ténèbres du Moyen Âge c’est occulter ce qui prélude. Les humanistes ont des précurseurs qui articulaient les mêmes critiques et posaient les mêmes questions.
L’étude des itinéraires et des tentatives d’émergence d’une pensée humaniste a pour point de départ la Grèce antique. Bien sûr, c’est à l’Égypte que nous devrons d’avoir, pour la première fois formulé clairement les notions de conscience individuelle et de justice sociale. Mais c’est à la civilisation grecque que revient l’invention de l’humanisme. L’inauguration de la pensée libre établit les bases indispensables à la connaissance et au progrès scientifique. Les concepts de démocratie, de justice, de vertu, de raison nous viennent du « miracle grec ». Puis, avec le triomphe du christianisme, c’est le long oubli de ce monde en pleine évolution. Le Moyen Âge, réputé l’Âge de foi, se caractérise par un système d’échange qui intègre l’économique rassurant et statique et le spirituel dogmatique. Toujours sous la tutelle de l’Église, qui possède à elle seule plus du tiers des terres d’Europe, on y voit cependant poindre un désir audacieux de liberté intellectuelle. D’Héloïse (1101- 1164) et d’Abélard (1079-1142) on se souvient de leur très beau roman d’amour qui est un chef-d’oeuvre de la littérature amoureuse. Il convient cependant de dire qu’Héloïse fut une grande intellectuelle, célèbre par sa science et sa culture, certes un des esprits les plus brillants de la fin du Moyen Âge. Abélard, philosophe, poète, professeur, déclara : « Ce n’était pas mon habitude d’avoir recours, pour professer, à la tradition, mais aux ressources de mon esprit. » Pour Abélard, qui s’attaque à toutes les valeurs reçues, à toutes les positions traditionnelles « la vie morale de l’individu ne doit pas être régie, mécaniquement, par une comptabilité, mais rationnellement, par une liberté d’appréciation » [1]. Selon L. Thoorens, Abélard préfigure les grands humanistes -Pétrarque, Érasme, Rabelais, Montaigne -qui sur des bases élargies et dans un autre climat, réaliseront la révolution qu’il concevait trop tôt [2].
L’Âge humaniste débute en Italie, bien avant partout ailleurs en Europe. C’est que, nous dit Thoorens, la société italienne éprouvait, au XIVe siècle, le besoin de cultiver l’intelligence et d’affirmer son individualisme. Elle en avait également le temps et les moyens. Son guide, elle le trouva dans l’Antiquité classique. Francesco Petracco (1304-1374), dont la passion des livres n’a d’égal que sa passion humaniste, apporte une conscience nouvelle à l’Occident. Renan le qualifiera de « premier homme moderne ». On dit que sa rencontre avec Giovanni Boccacio (1313-1375) allait transformer l’histoire de la littérature européenne. Toujours selon Thoorens, l’apport de Boccace au mouvement humaniste fut considérable. Pétrarque et Boccace, enthousiasmés de leurs découvertes et de leurs innovations, dépassèrent largement leur temps. À l’aube du XVe siècle, la passion de Pétrarque et de Boccace apportera aux humanistes une valeur nouvelle et une réflexion novatrice qui se répandra partout en Europe : la critique historique. Plusieurs d’entre eux payèrent de leur vie cette trop grande liberté. Un constat voyait le jour dans ces esprits trop lucides : celui d’une « opposition irréconciliable et inacceptable entre la doctrine chrétienne et l’humanisme tel qu’on le vivait » [3].
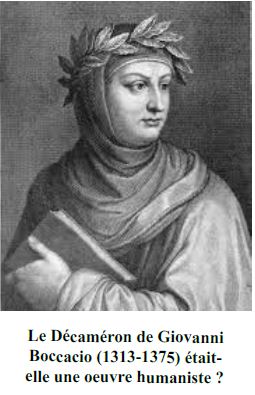
Les Lumières
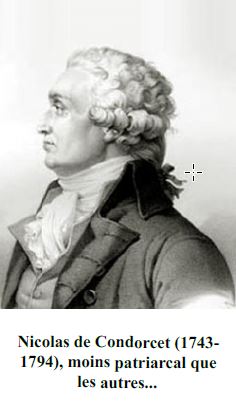
« Le mouvement déchaîné par la bourgeoisie dépassa rapidement ses aspirations, ses besoins, ses espérances. Elle avait réclamé l’égalité à son profit, mais le peuple la voulut aussi pour lui. La Révolution finit de la sorte par devenir le gouvernement populaire qu’elle n’était pas, et n’avait nullement l’intention d’être, tout d’abord ». La Révolution française, 1911.
Et Léon Thoorens :
« Dans les abîmes d’avenir, la Révolution est une promesse et une espérance… Car les fils de Montesquieu, Voltaire et Diderot, n’étaient nullement des démocrates, et le fils de Rousseau qui déchaîna la Terreur pas davantage : ils avalent de l’Homme, des hommes, de la Société, de l’équilibre des classes, des conceptions moins claires et moins pures qu’ils ne le pensaient eux-mêmes. » Panorama des Littératures [9]
Avant d’en terminer avec cette époque et ces « Amis de la Liberté », il me faut dire cette distorsion de la pensée des hommes et de la réalité des femmes. Celles-ci participèrent activement à la Révolution. Dès 1789, elles firent circuler de nombreux journaux, réclamant justice pour elles comme pour les autres opprimés. Que dire également de l’« impudente » Olympe de Gouges qui publia en 1791 une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : « Puisque les femmes ont droit à la guillotine, écrivait-elle, elles doivent également avoir droit à la tribune » Elle paya son « erreur » sur l’échafaud.
L’humanisme et le libéralisme passés et futurs ne s’encombreront pas de l’oppression des femmes.
Une exception cependant : Condorcet, « un émouvant personnage que nous devrions admettre dans notre Panthéon à nous ». [10].
En conclusion, il faut aussi constater que la philosophie et la Raison qui parlent d’« humanité » à l’époque des Lumières, parlent de quelque chose considéré comme viril-(virago), de masculin. Comme le dit Jean François Lyotard : la « philosophie donnait un tour très viril à la position du sujet par rapport au monde. Descartes n’avait-il pas fait de l’homme le maître, le possesseur ou le conquérant du monde ? » [11] De plus, il importe de souligner que la philosophie et la raison des Lumières « ne sont le lot que d’une très petite minorité de privilégiés de l’intelligence. (Ils) établissent (cependant) les conditions d’une attitude intellectuelle qui mettra de plus en plus en accusation la superstition, le surnaturalisme, l’intransigeance dogmatique et qui ouvrira le chemin de la tolérance, de la confiance en la raison et de la liberté.» [12]
La modernité
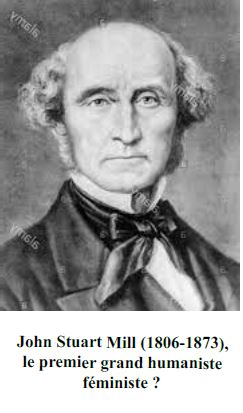
Cependant, le féminisme demeure le courant de pensée et d’action le plus significatif d’un humanisme réel et fécond. Au Québec, c’est en 1912 que sera fondée la première association de suffragettes. La campagne contre le mouvement est terrible, l’opposition du clergé, virulent. Thérèse Casgrain devient, dès 1921, un des piliers du mouvement féministe. « Plus que féministe, Thérèse Casgrain est une humaniste, toujours prête à se lancer dans les luttes pour les libertés civiles et les droits de la personne. [13] Durant les années 60 naîtra le néo féminisme international. D’origine américaine, le féminisme radical envahit le Canada anglais en 1967, et gagne l’Angleterre puis la France après la contestation de mai 68. Fin 69, le mouvement s’implante au Québec. Le féminisme d’ici est alors étroitement lié aux luttes de libération nationale. Puis, tout à coup, quelque chose survient qui secoue la réflexion : l’arrestation, le procès et l’emprisonnement du Dr Henry Morgentaler. La défense d’un droit fondamental, celui du libre choix à l’avortement, unira et regroupera les forces féministes. Pendant les années 70, alors que la violence éclate un peu partout dans le monde (injustice sociale, prisons, camps de réfugié-e-s, armements, terrorisme, etc.) les féministes entreprennent de dire la vie autrement. Impliquées dans toutes les causes, elles s’insèrent avec obstination dans « la trame de l’histoire des hommes. ». Dans l’espoir de redéfinir le monde à partir du vécu des femmes, elles remettent également en question le monopole de la rationalité des hommes. « Un rationalisme conséquent n’est jamais dogmatique » et « Quand l’expérience contredit la raison, cela signifie que l’expérience a raison et que la raison a tort » disait Langevin. Les libertés du monde moderne, conquises par de hautes luttes, demeurent pourtant fragiles et souvent illusoires. La relativité de tout ce qui nous entoure (pensée, valeur, comportement, science, institution) exige des ajustements permanents. Cependant, de concepts finalistes et de vérité absolue, le XXe siècle est passé à la « sagesse » des hypothèses inventées librement par l’esprit humain. C’est la victoire de l’humanisme sur le déterminisme supra-humain.
Aujourd’hui et demain ?
« Le problème idéologique central qui se traduisit en une lutte permanente entre orthodoxies et hérésies est une tentative toujours présente, jamais victorieuse ou définitivement vaincue, de concilier l’éthique religieuse avec la multitude, la variété et la vigueur des idées, des ambitions, des intérêts séculiers, ceux de l’esprit comme ceux de la chair et du corps. » Arnould Ciausse [14]
Les divers courants humanistes s’enfilent dans l’histoire et les oppositions demeurent tenaces. De l’humanisme « déiste » à l’humanisme « athée » (ou scientifique, ou laïque, ou…), la tolérance nous demande de faire un choix personnel entre tutelle et émancipation, entre sujétion et indépendance. Cependant, nous avons constaté à travers l’histoire, que déistes et athées ou sceptiques ont apporté, chacun et chacune à leur façon, une forme de pensée progressiste, optimiste et nécessaire au progrès humain. C’est encore et toujours le dogmatisme, le totalitarisme que nous devons combattre et non pas le libéralisme intelligent et fécond. Car, comme le dit L. Thoorens, il demeure « l’expression d’une pensée humaine circonstancielle et non celle d’une volonté divine. »
Dans ce monde actuel où l’inattendu devient possible, où la connaissance de nos limites s’est transformée en incertitude, ne devrions-nous pas réviser complètement la position du sujet humain ? Or, nous constatons que les années 80 sont un retour à un néo-conservatisme tranquille. La science et la technologie ont apporté de nouvelles valeurs individualistes. Les idées à la mode se retrouvent dans l’économique et l’entrepreneuriat. Aux grandes révolutions des années 60-70, succède un immobilisme confortable. Le présent est apparemment vide de vision progressiste, de projet de société comme de pensées nouvelles. Au Québec, les intellectuel-le-s se taisent. Pourquoi ? C’est que, et nous l’avons constaté ailleurs dans l’histoire, certain-e-s de ces contestataires de la Révolution tranquille et du féminisme se retrouvent aujourd’hui les élu-e-s de la société. Les autres, plus marginales-aux, ne sont pas encore sorti-e-s de « l’état de choc ». Elles et ils font présentement le bilan, « historisent » le passé et gardent le silence sur le présent et l’avenir.
Comme le dit Éric Alsène: « La critique est devenue aujourd’hui un véritable luxe, le goût pour l’innovation sociale, une hérésie scientifique. » [15] L’histoire de l’humanisme a démontré qu’elles n’étaient qu’un va-et-vient d’immobilisme et de renaissance qui, en définitive, nous conduit de plus en plus vers le progrès et l’épanouissement de l’être humain. Cependant, contrairement au passé, pouvons-nous, aujourd’hui, attendre la prochaine révolution ? Alors que l’humanité a devant elle des perspectives infinies d’épanouissement et de libération, elle a également, pour la première fois dans l’histoire, la possibilité de s’autodétruire. Et si cette humanité survit, quelle forme prendra le nouvel humanisme de demain ?
Citations
- Léon Thoorens, Panorama des littératures, Tome 2, p. 229.
- Ibid, p. 230.
- Ibid, Tome 3, p. 213.
- Ibid, Tome 2, p. 271.
- Ibid, Tome 6, p. 138.
- Ibid, p. 1 42.
- Ibid.
- Arnould Clausse, L’Épopée laïque, p. 214.
- Léon Thoorens, Panorama des littératures, Tome 7, p. 81 .
- Benoîte Groult, Ainsi soit-elle, p. 44 et p. 50.
- J. François Lyotard, L’Énigme du féminin, Cahier no 22.
- Arnould Clausse, L’Épopée laïque, p. 261.
- Le collectif Cléo, L’Histoire des femmes au Québec, p. 374.
- Arnould Clausse, L’Épopée laïque, p. 99.
- Éric Alsène, Dans la revue Possibles, p. 20.
Références d’appoint
-Asimov, Isaac, La conquête du savoir, Éd. Mazarine, Paris, 1982.
-Bercoff – Delville – Salomon, Nous, le livre des possibilités, Éd. Robert Laffont, 1984.
-Ciausse, Arnould, L’Épopée Laïque ou la conquête des Libertés, Éd. Laber, Belgique, 1981.
-Dictionnaire Rationaliste, Éd. Rationalistes, Paris, 1981.
-Friedan, Betty, La femme mystifiée, Denoel Gonthier, 1964.
-Friedan, Betty, Femmes, Le second souffle, Stanké, 1983.
-Groult, Benoîte, Ainsi soit-elle, Livre de Poche, Paris, 1975.
-Le Collectif Cléo, L ‘Histoire des Femmes au Québec, Éd. Les Quinze, Québec 1983.
-Entretien, L’Énigme du féminin, Cahiers 1 à 22, Service des transcriptions et dérivés de Radio Canada, Montréal, 1985.
-Mill, John Stuart, L’asservissement des femmes, P.B.P., Paris, 1975.
-Possibles, Du côté des Intellectuel-le-s,Vol. 10, no 2, Hiver, 1986.
-Rostand, Jean, Carnet d’un biologiste, Éd. Stock, 1 959.
-Russell, Bertrand, Pourquoi je ne suis pas chrétien, Éd. de l’Idée Libre, 1929.
-Russell, Bertrand, Essais sceptiques, P.U.F., 1951.
-Russel, Bertrand, Science et religion, Gallimard, 1971.

0 commentaires