
Jean Delisle
Traducteur
Jean Delisle est un auteur, un professeur de traduction, un traducteur agréé, un terminologue agréé, un traductologue et un historien de la traduction canadien. Il a rédigé de nombreux ouvrages spécialisés concernant la traduction, notamment quant à l’histoire de la traduction et de la terminologie au Canada. Il est professeur émérite de l’Université d’Ottawa et également membre de l’Association humaniste du Québec.
Merci de m’avoir transmis ton message. Tu as mis le doigt sur le bobo: l’attitude woke, qui empoisonne tous les débats publics et universitaires, est une entrave à la liberté de pensée, à l’esprit critique. L’Université d’Ottawa, où j’ai fait toute ma carrière, hélas! a plus ou moins lancé le bal dans la capitale et cela a fait tache d’huile. Impossible de refermer la boîte de Pandore. Il y a actuellement un réel malaise au sein de l’université et ce n’est pas un « beau malaise ». Mais je vois par ton message que le mal atteint aussi les musées. Personne ne veut vivre les événements disgracieux qui ont eu lieu en 2017 à l’Université The Evergreen State College, à Olympia, dans l’État de Washington[1]. Un sommet à ne jamais dépasser! Cela donne froid dans le dos. Le juge Bastarache a été mandaté par l’UdO pour présider un comité qui a sollicité des mémoires sur la question. J’en ai présenté un, mais avec un recteur comme Jacques Frémont, le père des « microagressions » pour qui critiquer les religions est un acte haineux, je vois mal comment le chancre du wokisme pourra disparaître. L’AHQ a du pain sur la planche! Salutations cordiales. Jean Delisle»
Gatineau, le 20 mai 2021
L’honorable Juge Michel Bastarache, président
Comité sur la liberté académique
Université d’Ottawa
Monsieur le Juge,
Je vous remercie de m’offrir la possibilité de vous faire part de mon point de vue sur la liberté académique et la liberté d’expression. Je suis professeur émérite de l’Université d’Ottawa, où j’ai fait toute ma carrière. Mes deux champs de spécialisation sont l’enseignement et l’histoire de la traduction.
Disons, en guise de préambule, que l’étude de la traduction et de son histoire nous apprend que traduire, c’est faire un détour par l’Autre. Cet élan vers l’Autre est antithétique de la vision tunnel inhérente à la « culture du bannissement » (cancel culture) et aux « espaces sécurisés » (safe space) qui élèvent des cloisons, renferment dans l’identique et bannit l’esprit critique. Un espace sécurité est une serre chaude, un endroit étriqué où l’on pratique la monoculture. Or, le traducteur, ouvert à l’Autre et à l’exploration de nouveaux horizons, pratique, quant à lui, la polyculture, celle qui rend possible la confrontation des idées et l’enrichissement culturel. C’est la raison d’être des collections d’œuvres étrangères en traduction que publient les grandes maisons d’édition.
Mon témoignage repose sur ces préalables d’ouverture, d’exploration et de respect que m’inspirent mes domaines de recherche ainsi que la cinquantaine d’années passées dans le milieu universitaire, d’abord comme étudiant (Montréal, Paris), puis comme professeur (Ottawa). J’ai quitté l’enseignement en 2007.
D’emblée, je vous fais part de ma profonde aversion pour la culture de la dénonciation, du bâillonnement, de la victimisation et du clientélisme.
Comme il est inutile de réinventer la roue, je me permets de reprendre intégralement les deux définitions suivantes extraites de Wikipédia :
« La liberté académique ou liberté universitaire est la liberté que les étudiants et le personnel universitaires ont le droit d’avoir quant aux recherches, aux enseignements et à ce qui est exprimé, sans subir de pressions économiques, politiques ou autres. »
« La liberté d’expression inclut le droit d’exprimer des opinions controversées et dérangeantes, ainsi que de critiquer des idées et des valeurs sans avoir peur de subir des représailles. Elle fait partie des libertés et des droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.
Bien que fondamentale, la liberté d’expression n’est pas absolue et ne prime pas sur les autres droits garantis par la Charte : elle ne peut pas servir à justifier des propos racistes, sexistes ou homophobes, par exemple. En effet, la liberté d’expression, même artistique ou humoristique, peut être limitée. C’est le cas si elle nuit au droit à l’image et à la vie privée d’une personne ou à son droit à la dignité, par exemple. »
Si je reconnais qu’un professeur a un lien contractuel fort avec l’université qui l’a engagé sur la base de ses diplômes, de ses connaissances spécialisées et de ses compétences et qualifications attestées, cela n’implique pas pour autant que les administrateurs de cette même université peuvent lui imposer jusqu’au vocabulaire qu’il doit ou ne doit pas employer en salle de classe. Je vois cela comme un abus d’autorité. Dans un pays libre et démocratique comme le Canada, la seule obligation du professeur dans son travail d’accompagnement des étudiants dans leur apprentissage est d’exercer son jugement et de ne pas user d’expressions visant à offenser ou humilier délibérément un étudiant ou un groupe d’étudiants. Sur ce point, il n’y a pas débat. La cause est entendue.
Je reconnais également que tous les étudiants (comme tous les professeurs, d’ailleurs) n’ont pas la même sensibilité à l’égard de certains mots, de certains concepts ou de certaines théories (le créationnisme, par ex., ou l’athéisme), mais la réflexion et la transmission des connaissances doivent toujours primer sur la sensibilité des étudiants, ceux qui se disent victimes de « micro-agressions », notion subjective à souhait. Pour le dire autrement, un contenu de cours et sa prestation ne doivent pas être subordonnés à la sensibilité individuelle des étudiants.
Ce principe m’apparaît fondamental et relève de la liberté académique dont jouit le professeur, liberté qui recoupe ici la liberté d’expression et le devoir de transmettre des savoirs. Sinon, on enferme l’enseignement dans l’arbitraire, le relativisme et le subjectivisme paralysant, et on compromet la transmission des connaissances. Et c’est sans compter que tel étudiant sera sensible à ceci, tel autre à cela. Où tracer la ligne? L’enseignement n’est pas une course à obstacles (à éviter). Permettez-moi d’illustrer mon propos par un exemple concret, qui sera, je l’espère, plus éclairant qu’une longue dissertation théorique.
J’ai eu l’occasion dans mes cours pratiques de traduction de traiter des mots nigger et nègre. Lorsqu’il m’arrivait de discuter des équivalents anglais de l’expression « il y a anguille sous roche » ‒ locution qui se traduit, entre autres, par something fishy is going on ‒, je faisais remarquer à mes étudiants que la langue américaine possède aussi l’expression « There is a nigger in the woodpile ».
Je prenais soin de préciser que l’origine de cet américanisme remonte à l’époque où les esclaves noirs en fuite devaient se cacher pour échapper à leurs poursuivants. Courante jusqu’au début du 20e siècle, l’expression a été perçue, à juste titre, comme raciste et n’est plus guère employée, bien qu’elle soit figée dans des œuvres littéraires américaines.
Personne dans la classe, y compris les étudiants noirs, ne réagissait violemment à mes propos. Personne n’a monté de cabale contre moi. Personne ne m’a accusé de les insulter. Personne ne m’a menacé d’expulsion. Personne n’a demandé qu’on me retire mon doctorat. Personne ne m’a dénoncé aux autorités pour avoir prononcé le mot nigger. (Plusieurs de mes anciens collègues ont vécu tout cela dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Lieutenant-Duval »).
Les étudiants, semble-t-il, savaient faire la différence entre « militantisme », « apprentissage » et « insultes ». Il semble que ce ne soit plus le cas de nos jours, si l’on en juge par l’attitude de certains individus. Les professeurs qui ont le malheur d’employer ces mots, sans la moindre intention d’offenser qui que ce soit, sont perçus comme des blasphémateurs ou des racistes par ceux que je n’hésite pas à qualifier d’« islamistes du langage ». J’y vois une entrave à la liberté académique.
Les professeurs doivent-ils craindre désormais d’être décapités chaque fois qu’ils appellent un chat un chat ou qu’ils utilisent un mot qui ne fait pas consensus?
Dans le climat toxique et anti-intellectuel qui règne actuellement en certains milieux, je me demande si je pourrais encore mettre en garde mes étudiants contre certains usages critiqués ou à proscrire. Pourrais-je leur dire, par exemple, d’éviter d’employer le mot « nègre » (ghostwriter) pour désigner la personne qui écrit anonymement des ouvrages signés par un autre, bien que cette acception soit consignée dans les dictionnaires d’usage et que le mot figure dans des romans relativement récents[1]? Qu’il vaut mieux éviter les expressions dépréciatives telles que « parler petit-nègre », « plan de nègre » et « travailler comme un nègre »? Pourrais-je leur dire que « tête-de-nègre » désigne une couleur?
Devrais-je pratiquer ce que j’appelle l’autocensure de l’ignorance, car c’est bien de cela qu’il s’agit?
J’invite ceux qui veulent mettre certains mots à l’index et qui prônent la censure lexicale en milieu universitaire à méditer cette pensée du poète chinois Wou Tsien Ki : « Si quelqu’un t’enlève les mots de la bouche, ne crie pas au voleur, le langage n’appartient à personne – au contraire du silence ». Combien de mots seront ainsi mis à l’index? Lesquels? Faudra-t-il les désigner par ce procédé absurde qui consiste à les remplacer par leur lettre initiale (mot en n, … en h, … en p, …en s)? Qui décidera? Le cadre universitaire n’est pas un lieu clos comme une Assemblée nationale, où il existe une liste de mots à proscrire pour que les débats restent respectueux et que les députés gardent le décorum.
Dans l’affaire Lieutenant-Duval, qui a terni l’image de l’Université d’Ottawa, ce qui a été brimé ce n’est pas tant la liberté académique que le droit de l’ensemble des étudiants de la classe de débattre raisonnablement d’un sujet sensible, de réfléchir sereinement à une situation problématique. La plainte d’une seule étudiante et les maladresses de deux administrateurs universitaires ont eu pour effet de verrouiller le débat. Il y a eu manifestement entrave à la liberté académique de la chargée de cours.
N’est-ce pas la mission de l’université que de susciter des débats, d’ouvrir les esprits? Si l’éducation est la sage-femme de la démocratie, selon John Dewey, l’université doit être la « maison des naissances », pour filer la métaphore du philosophe. Tout le contraire d’une tribune pour militants, d’une arène de luttes politiques.
Si l’université se soumettait aveuglément aux diktats de minorités victimaires et les laissait définir la « rectitude politique », en l’occurrence la « rectitude académique », elle ouvrirait la porte aux pires dérives. J’en veux pour preuve ce professeur d’un établissement anglophone de Montréal qui a réclamé le retrait d’un manuel d’histoire du Québec qui fait mention du livre de Pierre Vallières Nègres blancs d’Amérique (1968). On croit entendre Tartuffe s’écrier :
Couvrez ce nègre (sein) que je ne saurais voir.
Par de pareils objets, les âmes sont blessées,
Et cela fait venir de coupables pensées.
(Acte III, sc. 2)
Tartufferies, en effet. Va-t-on retirer des bibliothèques tous les ouvrages qui renferment les mots nigger, nègre, sauvage ou tapette, sous prétexte que certains individus y voient des « micro-agressions »? Va-t-on faire des autodafés avec tous les dictionnaires qui renferment ces mêmes mots? Poser la question, c’est mesurer toute l’absurdité de la chose. On adapte et on expurge les livres ad usum Delphini, pas une bibliothèque universitaire!
Comme tous les professeurs, je suis évidemment contre le racisme sous toutes ses formes, mais, hélas, on a tendance à voir du racisme là où il n’y en a pas et à clouer au pilori des professeurs qui font leur travail sans la moindre arrière-pensée raciste. Dans l’affaire Lieutenant-Duval, le débat a glissé plus ou moins subrepticement d’un cas d’emploi du mot nigger dans une discussion académique (à la suite d’une plainte formulée par une seule étudiante, il faut le rappeler) à une situation de « racisme systémique » sur tout le campus.
Le plus étonnant est que ce glissement a été cautionné (ou indirectement provoqué) par ceux-là mêmes qui avaient mission de défendre la liberté académique, les administrateurs universitaires, qui se sont rangés spontanément du côté des étudiants. Lorsque l’affaire a pris de l’ampleur, beaucoup de professeurs ont été victimes de harcèlement et de menaces (voir ci-dessus) par les mêmes étudiants qui se disaient victimes d’agression. Situation pour le moins paradoxale, voire kafkaïenne.
On a assisté également à une fracture entre les professeurs francophones, qui sont montés aux créneaux pour défendre la liberté académique, et les anglophones qui, pétris sans doute de valeurs multiculturelles[2], sont restés étrangement silencieux, comme si cela ne les concernait pas. Le multiculturalisme, « c’est le chacun pour soi dans un empire de différences respectées[3] ». Les groupes communautaires dans un tel système se côtoient sans réellement se mêler. Si, en tant que politique officielle d’un pays, le multiculturalisme peut véhiculer une image forte de tolérance et de diversité culturelle et s’afficher comme un rempart contre le racisme et la discrimination (ce qui n’est pas forcément le cas, il y a 30 % plus de cas de racisme en Ontario qu’au Québec), il risque aussi de réduire une culture ou une race à son folklore et, dans le cas qui nous occupe, à ses revendications et à ses luttes sociales, parfois au mépris d’autres valeurs, dont la liberté académique. Le multiculturalisme se distingue de l’interculturalisme, système d’organisation sociale auquel les francophones de la nation québécoise semblent aussi attachés qu’à la langue française, à la laïcité et à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il y aurait beaucoup à dire sur cette différence de perception qui cohabite à l’Université d’Ottawa qui, à cet égard, est à l’image de la société canadienne, mais cela nous éloignerait de notre sujet.
Si je suis farouchement contre toute forme de racisme, d’homophobie, d’islamophobie et de sexisme, je désapprouve tout autant les étudiants qui sont incapables de faire preuve d’esprit critique, car, au fond, c’est là que le bât blesse. Je crois pouvoir dire que je partage ce point de vue avec une majorité de professeurs et d’observateurs du monde de l’éducation. Si l’on veut mettre fin une fois pour toutes à une situation qui pourrit le climat universitaire, il va falloir que les étudiants comprennent et acceptent : a) qu’employer à des fins d’enseignement des mots comme nigger, nègre, sauvage ou tapette n’est pas un acte de racisme ni une insulte, b) qu’une œuvre ne saurait être retirée d’une liste de lecture du seul fait qu’elle renferme des mots qui ne plaisent pas à certains membres d’un groupe, c) qu’on ne peut pas remplacer les mots « liberté académique » et « liberté d’expression » par la « censure » ou ses préférences personnelles, d) qu’il revient aux professeurs d’expérience d’élaborer le contenu des programmes universitaires et que cela ne doit pas se faire en fonction de sa sensibilité des étudiants. Tout peut faire l’objet d’étude et de recherche dans une université d’un pays libre comme le Canada, où existent à la fois la liberté académique et la liberté d’expression.
Une formation universitaire doit enseigner la différence entre une opinion (argumentée), une humeur (ressentie), une croyance (religieuse) ou une rumeur (dont il faut établir la véracité). L’absence d’esprit critique ne doit pas tenir lieu de tolérance et de respect. On a prétendu, par exemple, que faire la critique des religions est un acte haineux! Si l’on admettait cette énormité, on ne pourrait pas dénoncer la discrimination dont les femmes sont victimes dans la plupart des religions; on ne pourrait pas dénoncer l’homophobie des trois religions monothéistes, etc.
La liberté académique consiste à pouvoir discuter de tels sujets dans l’enceinte d’une université; la liberté d’expression est de pouvoir le faire aussi publiquement et librement, sans crainte de représailles.
Dans les onze pays qui condamnent encore les homosexuels à la peine de mort, il n’y a ni liberté académique ni liberté d’expression sur ce sujet précis. Que des dogmes, des préjugés et de l’ignorance. N’importons pas des États-Unis ce qu’il y a de plus néfaste pour la pensée rationnelle et le vivre-ensemble, et sachons nous libérer de ces chancres mous que sont la « culture du bannissement » et les « espaces sécurisés » aux effets infantilisants.
Si l’université, établissement de haut savoir qui forme l’élite de demain, n’arrive pas à inculquer à ses futurs diplômés un esprit critique en contexte pédagogique, si elle est incapable d’apprendre aux futurs leaders à faire la part des choses, alors l’université manque cruellement à sa mission. Elle n’est plus ce lieu de réflexion, de recherche et d’avancement des connaissances, mais un navire à la dérive, ballotté par les courants de l’émotivité, de la subjectivité et de l’obscurantisme, ces courants qui submergent les réseaux sociaux, dont on a dit qu’ils « élèvent les propos de taverne au rang d’opinion ».
Il y a actuellement un réel malaise au sein de l’université et ce n’est pas un « beau malaise ». Personne ne veut vivre les événements disgracieux qui ont eu lieu en 2017 à l’Université The Evergreen State College, à Olympia, dans l’État de Washington[4]. Cela donne froid dans le dos. Il est encore temps de changer de cap en donnant un vigoureux coup de barre en direction du gros bon sens. […]
Je me réjouis qu’un comité se penche sur l’application concrète de la « liberté académique » et de la « liberté d’expression » afin que s’instaure de nouveau à l’Université d’Ottawa un climat serein d’apprentissage et de recherche digne d’une grande université. Mes meilleurs vœux de succès accompagnent les membres du comité.
En espérant que ces quelques considérations tirées de mon expérience personnelle et de ma connaissance de la situation à l’Université d’Ottawa puissent être utiles aux membres du Comité, je vous prie d’agréer, Monsieur le Juge, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Jean Delisle, MSRC
Professeur émérite
Université d’Ottawa
Site Web et CV : https://uottawa.academia.edu/JeanDelisle
[1] Voir Claude Bleton, Les nègres du traducteur (Métailié, 2004), Hélène Rioux, Âme en peine au paradis perdu (XYZ, 2009, p. 42), Le cimetière des éléphants (XYZ, 1998, p. 24).
[2] Le multiculturalisme envisage les cultures comme des ensembles « autonomes » de valeurs, de références intellectuelles et artistiques communes à un groupe donné facilement identifiable. Cela suppose que chacun fait partie d’une seule culture et que ses relations aux autres sont fondées sur la tolérance interculturelle. Le multiculturalisme découpe la société en groupes selon la race, la religion, le pays d’origine des ancêtres.
[3] Sherry Simon, Hybridité culturelle, Montréal, L’Île de la Tortue, 1999, p. 19.
[4] Pour visionner le documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=u54cAvqLRpA&t=7s

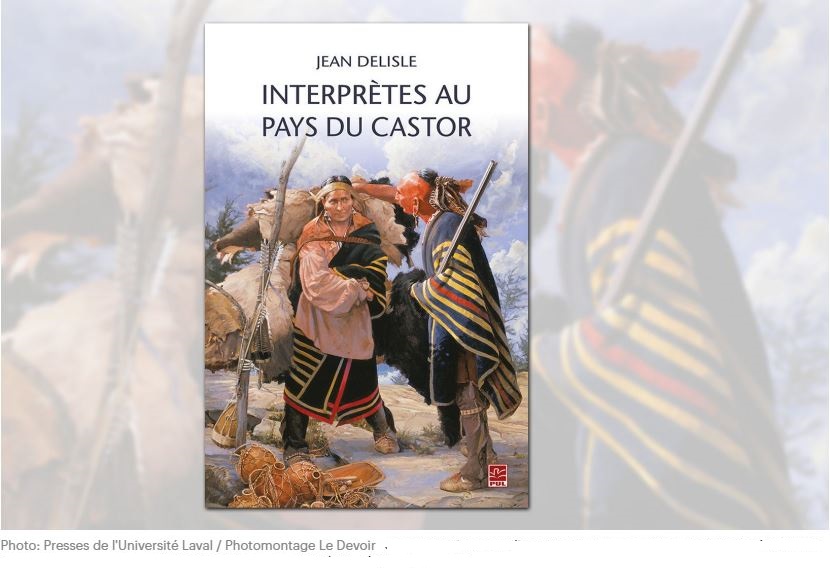

0 commentaires