Le populisme est-il bon pour la démocratie ?

Jean Delisle
Traducteur
Jean Delisle est un auteur, un professeur de traduction, un traducteur agréé, un terminologue agréé, un traductologue et un historien de la traduction canadien. Il a rédigé de nombreux ouvrages spécialisés concernant la traduction, notamment quant à l’histoire de la traduction et de la terminologie au Canada. Il est professeur émérite de l’Université d’Ottawa et également membre de l’Association humaniste du Québec.
James Miller
Article de fond du Guardian, 11 octobre 2018.
Publié avec l’autorisation de l’auteur, de l’éditeur du livre et du journal The Guardian
Traduit par Jean Delisle
Une vague de révoltes populistes a ébranlé la confiance des gens dans la sagesse du peuple, mais de telles révoltes sont essentielles à la vitalité de la démocratie moderne.
Tout le monde semble convenir que la démocratie est menacée. Ce qui étonne, c’est que beaucoup de ses partisans en sont venus à craindre la démocratie elle-même, ou que la population d’un pays, aveuglée par des enjeux qui soulèvent les passions, risque de transformer la politique en un combat sanglant et disgracieux, opposant « le peuple contre la démocratie » [1].
Les observateurs ont des inquiétudes compréhensibles vis-à-vis de programmes politiques attentatoires, mais endossés démocratiquement par une majorité de citoyens. Ainsi, en Pologne comme en Hongrie, les partis au pouvoir accusent les migrants musulmans de faire perdre au pays son identité chrétienne. Aux Philippines, Rodrigo Duterte, qui gouverne avec une poigne de fer, menace les trafiquants de drogue de les envoyer dans les salons funéraires plutôt qu’en prison.
Les démocraties modernes reposent toutes sur la prémisse que le peuple est souverain. Tous les gouvernements légitimes prétendent détenir leur pouvoir du peuple et se soumettre à sa volonté. Pourtant, lorsqu’une large majorité de citoyens soutient avec force une politique que d’aucuns jugent odieuse, de nombreux libéraux, et même des démocrates déclarés, refusent de faire connaître leur opposition à cette politique. D’où le paradoxe troublant suivant : « Les démocraties disparaissent lorsqu’elles deviennent trop démocratiques ». C’est ce que concluait en 2016 un observateur de la scène politique, l’Américain Andrew Sullivan, qui reprenait à son compte ce qu’avait dit deux générations avant lui Samuel Huntington dans un rapport intitulé The Crisis of Democracy (1975), publié à la suite des manifestations étudiantes ayant éclaté un peu partout dans le monde dans les années 1960.
Même la chercheuse de gauche Chantal Mouffe, qui a longtemps considéré l’affrontement comme l’essence de la « démocratie radicale », semble désemparée devant la tournure de l’actualité. « Une démocratie qui fonctionne bien, a-t-elle dit en entrevue récemment, c’est-à-dire une démocratie dans laquelle il y a, certes, de fortes divergences de vues, mais où les gens acceptent l’existence de leurs adversaires, n’est pas facile à rétablir. » La tolérance est à ses yeux une des valeurs libérales les plus menacées. « Je ne suis pas très optimiste », dit-elle.

La situation actuelle peut sembler particulièrement préoccupante, mais les craintes que suscite la démocratie ne datent pas d’hier. Aux beaux jours de la démocratie directe, à Athènes, au Ve siècle avant notre ère, on a qualifié la démocratie de « pure absurdité ». C’est aussi ce que la plupart des penseurs ont cru, depuis Aristote jusqu’à Edmund Burke. À leurs yeux, la démocratie était « la pire chose au monde ». John Adams a dit : « Il n’y a jamais eu de démocratie qui ne se soit pas suicidée. » Pendant presque deux mille ans, la plupart des théoriciens occidentaux ont accepté ce postulat. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française pour que la démocratie réapparaisse comme un idéal politique. Depuis lors, les soulèvements populaires récurrents au nom de la démocratie font partie intégrante de la réalité politique dans le monde. On aurait tort d’y voir des incidents ponctuels d’une évolution pacifique conduisant vers une société plus juste. Ces événements constituent le cœur et l’âme même d’une réalité vivante qu’est la démocratie moderne.
C’est devenu une scène familière : une foule, issue, d’on ne sait trop où, se précipite sur une place dans un centre-ville ou participe à un rassemblement organisé par un orateur charismatique pour protester contre des institutions honnies, pour exprimer son dégoût des trahisons des élites ou pour prendre le contrôle des espaces publics. Qualifier de « populistes », au sens péjoratif du terme, ces soubresauts de liberté collective, bien que souvent inquiétants, c’est mal connaître la véritable nature de la démocratie moderne. Ces épisodes sont éphémères et entraînent souvent une contre-réaction. D’un point de vue politique, le désordre qu’elles occasionnent fait ressortir la nécessité ressentie d’une forme de participation collective plus stable et plus pacifique. C’est pourquoi de nombreux démocrates ont tenté de concevoir des institutions représentatives permettant à la fois l’expression et l’encadrement de la volonté souveraine du peuple.
Le grand philosophe Condorcet a imaginé, en 1793, une nouvelle forme d’autonomie, indirecte, en raccordant les assemblées locales à un gouvernement national. Son ami, Tom Paine, pensait lui aussi qu’« en greffant la représentation à la démocratie », le peuple pourrait exercer son pouvoir directement dans des assemblées locales et indirectement en confiant provisoirement certains de ses pouvoirs à des représentants élus. Dans la foulée des événements révolutionnaires, un autre ardent démocrate français, Robespierre, est allé encore plus loin en prônant une dictature temporaire, afin qu’il soit possible de construire une démocratie représentative durable, une fois ses ennemis vaincus et la loi et l’ordre rétablis. Mais ces tentatives visant à instaurer un régime démocratique moderne à grande échelle se heurtent à une difficulté de taille. Dans un grand pays comme la France ou les États-Unis, par exemple, tout comme dans les régimes dictatoriaux qui prétendent être l’incarnation d’une volonté populaire, les institutions représentatives risquent de mécontenter quiconque souhaite jouer un rôle plus direct dans la prise de décision politique. Cela signifie que les projets de démocratie, tant anciens que contemporains, sont intrinsèquement instables. La promesse de souveraineté du peuple, promesse non tenue bien souvent, pousse les peuples à revendiquer leur pouvoir. Ceux qui sont favorables à ces revendications y voient une renaissance de l’esprit démocratique. Les autres ont tendance à n’y voir que de l’agitation populaire.

Peu importe. Bien que le consensus apparu après la Deuxième Guerre mondiale sur la valeur des institutions démocratiques libérales semble plus fragile que jamais – selon les sondages, la confiance dans les élus n’a jamais été aussi faible –, la démocratie donne lieu à de violents actes de colère contre des élites déconnectées du peuple et contre ses ennemis cachés. Il est important de bien faire la distinction entre démocratie et libéralisme, deux mots lourdement chargés, qui, ces dernières années, ont été confondus, en particulier par les spécialistes des sciences sociales et les politicologues qui se désolent que la démocratie libérale occidentale, jadis « une Terre promise », soit devenue une « ennemie » dans des pays comme la Hongrie. Contrairement au terme démocratie, le mot « libéralisme » est entré assez tardivement dans notre vocabulaire politique. En Europe, il a été largement utilisé au XIXe siècle par divers théoriciens et hommes d’État français, allemands et italiens, partageant tous un même sentiment d’horreur face au bain de sang de la Révolution française, mais tous ne lui donnaient pas le même sens. La démocratie moderne n’a pas forcément de lien avec le libéralisme. Au XVIe siècle, les protestants qui faisaient la promotion de la souveraineté du peuple cherchaient avant tout à renverser les dirigeants avec lesquels ils divergeaient d’opinion en matière de religion. « Ils ne cherchaient pas à instaurer la liberté religieuse, mais à éradiquer les mauvaises religions », a écrit l’historien Edmund Morgan en 1988.
Il est clair aujourd’hui que si la démocratie fait largement consensus, elle est, sous sa forme libérale, une idéologie conflictuelle. Cela se voit par la montée de mouvements dans lesquels un groupe de citoyens se solidarise et se rallie autour d’un leader qui prétend parler en leur nom et incarner leur volonté. On assiste aussi à la résurgence des angoisses traditionnelles, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, à propos de la démocratie et de ses risques. Après tout, pourquoi devrions-nous confier le sort de la Terre aux citoyens ordinaires assez bêtes pour soutenir des politiques d’autodestruction et appuyer des dirigeants manifestement incompétents?
La plupart des grands esprits de l’Antiquité ont conspué la démocratie qui régnait à Athènes. Platon, qui a vécu sous un régime démocratique au IVe siècle, a critiqué les fausses croyances qui circulaient dans une ville gouvernée par l’opinion publique plutôt que par le vrai savoir. Il déplorait « l’insolence, l’anarchie, la licence et l’effronterie » [2] découlant de ces fausses croyances. Un autre citoyen d’Athènes, Thucydides, a décrit la guerre du Péloponnèse qui s’est terminée par la victoire de Sparte sur Athènes en 404. L’historien a imputé la défaite catastrophique d’Athènes au pouvoir consenti au peuple athénien rendu vulnérable et facilement manipulable par des orateurs mystificateurs aux arguments fallacieux.
Ces critiques, auxquelles il faut ajouter l’évolution de l’histoire politique depuis l’empire macédonien d’Alexandre le Grand jusqu’aux monarchies européennes de droit divin, ont fait en sorte que, pendant des siècles, on s’est totalement désintéressé du système politique athénien, c’est-à-dire de la démocratie en tant que forme de gouvernement.
La démocratie athénienne est assez éloignée des valeurs libérales modernes : à son apogée, aux Ve et IVe siècles avant notre ère, elle ne prévoit pas l’élection de la majeure partie de ceux qui gouvernent, elle ne protège pas non plus les droits de l’homme, car ces droits sont alors inconnus des citoyens, et les pouvoirs régissant la Cité ne sont pas tous consignés par écrit.
Ce qui existe à Athènes, c’est une communauté de citoyens qui sont tenus de participer à la vie politique de leur ville, et cela beaucoup plus activement que dans nos démocraties modernes. À l’époque de l’âge d’or de la démocratie athénienne, une assemblée de citoyens, ouverte à tous, se réunit au moins quarante fois par année. Tous les postes politiques sont occupés par des citoyens ordinaires, choisis au hasard, et tous les jugements des tribunaux sont rendus par de grands jurys composés également de citoyens ordinaires, sélectionnés de la même manière. Tout cela a eu lieu dans une grande ville commerciale qui a dominé le monde de la Méditerranée orientale pendant près de deux siècles.
Les institutions athéniennes sont nées à la suite d’un soulèvement populaire survenu en 508 avant notre ère contre les troupes spartiates qui s’étaient emparées de l’Acropole. Au lieu d’accepter l’occupation étrangère, les citoyens d’Athènes ont spontanément convergé vers l’Acropole et encerclé les envahisseurs. Il n’a fallu que trois jours à de simples citoyens pour chasser les Spartiates, ce qui laisse croire que le soulèvement populaire avait la force du nombre.
Il en a résulté une transformation radicale des institutions athéniennes et, un peu plus tard, est apparu le mot « démocratie » pour décrire un régime où le pouvoir (kratos) est entre les mains du peuple (démos). Dès lors, toute la législation d’Athènes devait être validée par l’Assemblée, désormais ouverte à tous les citoyens, même les plus pauvres. Plus important encore, le tirage au sort utilisé pour doter la plupart des postes de fonctionnaire et des jurys a eu pour effet d’éliminer la corruption dont profitaient les riches et les patriciens, avantagés par les élections.
En donnant ainsi à une multitude de gens modestes les moyens d’agir, l’Assemblée et les partisans de la démocratie ont été accusés d’avoir créé un nouveau genre de tyrannie, la tyrannie de la majorité. On leur a reproché d’avoir fait naître de facto un État-providence qui distribue de l’argent et des privilèges aux simples citoyens qui composent l’équipage des navires de la flotte impériale ainsi que le personnel des tribunaux et des services publics.
Pour Platon, le problème est d’ordre épistémologique : la « plèbe » n’a pas une idée claire de ce que sont la vérité et la justice. La démocratie corrompt même des citoyens intelligents en les amenant à adoucir leurs politiques pour se plier aux désirs des foules incultes. « Lorsque, dans les assemblées, les tribunaux, les théâtres, les camps et partout où il y a foule, ils blâment telles paroles ou telles actions, et approuvent telles autres, dans les deux cas à grand tumulte et de façon exagérée, criant et applaudissant tandis que les rochers et les lieux d’alentour font écho, et redoublent le fracas du blâme et de l’éloge. » [3]
Après l’éclipse du gouvernement direct par le peuple dans le monde antique, le concept de démocratie s’estompe. En Occident, il est utilisé par les juristes dans deux acceptions contradictoires. Le mot « démocratie » devient presque synonyme d’anarchie violente. Selon l’historien romain Polybe, « la licence et l’anarchie » inhérentes à la démocratie finissent par entraîner une « dictature du prolétariat », dernière étape du cycle de tout régime gouvernemental, le meilleure étant la monarchie, le pire, la démocratie qui conduit à la dictature du prolétariat.
Du même souffle, Polybe affirme que « la démocratie peut avoir un rôle constructif. Le régime politique le plus durable serait une république qui combinerait les trois formes naturelles de gouvernement : la monarchie, l’aristocratie et la démocratie. Imbriquées et soumises à un jeu d’équilibre de forces, ces trois formes de gouvernement donneraient une république forte et bien structurée, capable de résister aux vents violents du temps « comme un bateau bien construit ».
Au cours des siècles suivants émerge un courant de pensée républicain, inspiré de la Rome antique. À la Renaissance, des théoriciens d’allégeance républicaine se hasardent à suggérer que de simples citoyens pourraient jouer un rôle utile en tant que chiens de garde et soldats. Étant attachés à leur liberté, ils pourraient, en effet, surveiller les détenteurs du pouvoir et les administrateurs et dénoncer toute forme de malversation. Ce même attachement, par l’esprit de corps qu’il susciterait, pourrait également contribuer à renforcer la puissance militaire d’une République. Machiavel, qui rêve de voir l’Italie retrouver sa gloire d’antan, souhaite exploiter cette ferveur populaire : « Les meilleures armées, dit-il, sont formées de citoyens en armes », plutôt que de mercenaires rémunérés.
Parallèlement, les penseurs républicains croient que le principal danger que représente une constitution mixte vient de la composante démocratique, en raison de sa tendance à générer violence et anarchie. Machiavel lance cet avertissement : « les gens, livrés à eux-mêmes, deviennent des « promoteurs de licence ». Le républicain anglais Algernon Sidney, jugé comme traître et décapité en 1683 pour ses prises de position républicaines, nie être un partisan de la démocratie pure. Pour sa part, le philosophe des Lumières, Montesquieu, s’inquiète aussi vivement de « l’esprit d’extrême égalité », typique, selon lui, des démocraties. Même aux États-Unis, à la suite d’une guerre contre le pouvoir colonial détenu par un monarque d’un lointain pays et en pleine période d’affirmation du pouvoir du peuple, les théoriciens politiques manipulent avec la plus grande prudence le concept de démocratie, si tant est qu’ils l’acceptent.
Dans ce contexte, les écrits politiques de Jean-Jacques Rousseau produisent l’effet d’une bombe. En substance, le philosophe redéfinit de manière audacieuse la souveraineté en termes de démocratie. Avant lui, la « souveraineté » implique la force brute, l’empire et la capacité de commander. Rousseau la redéfinit non pas en fonction de la puissance des monarques, mais du pouvoir légitime du peuple. Après la Révolution française, il fait figure de prophète pour avoir écrit en 1762 dans son Émile : « Le Grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet : les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d’en être exempt ? Nous approchons de l’état de crise et du siècle des révolutions. » [4]
À l’été de 1792, des militants inspirés par les thèses de Rousseau affirment que le pouvoir politique, au sens propre du terme, n’appartient ni au roi ni aux représentants élus, mais aux personnes rassemblées dans leurs quartiers, où elles peuvent discuter face à face de leur destin commun. La situation atteint un point de bascule le 10 août 1792. Une majorité de ces assemblées locales décident alors que seule une révolte armée peut garantir la souveraineté du peuple français. À minuit, les sans-culottes s’emparent de la mairie, puis, dans la matinée, envahissent les appartements du roi aux Tuileries, bien qu’à ce moment-là, le roi et sa famille aient déjà pris la fuite.
Un témoin des violences perpétrées ce jour-là raconte ce qu’il a vu : « Je suis resté […] jusqu’à quatre heures de l’après-midi et j’ai vu toutes les horreurs qui ont été commises. Des hommes continuaient le massacre; d’autres coupaient la tête de ceux qui avaient été tués; des femmes, sans la moindre pudeur, commettaient les mutilations les plus indécentes sur les cadavres dont elles arrachaient des lambeaux de chair qu’elles exhibaient en triomphe. […] Vers la fin de la journée, j’ai pris le chemin de Versailles […] et traversé le pont Louis XVI [5]; il était jonché de cadavres d’hommes nus en état de putréfaction en raison de l’intense chaleur. »
Un témoin des violences perpétrées ce jour-là raconte ce qu’il a vu : « Je suis resté […] jusqu’à quatre heures de l’après-midi et j’ai vu toutes les horreurs qui ont été commises. Des hommes continuaient le massacre; d’autres coupaient la tête de ceux qui avaient été tués; des femmes, sans la moindre pudeur, commettaient les mutilations les plus indécentes sur les cadavres dont elles arrachaient des lambeaux de chair qu’elles exhibaient en triomphe. […] Vers la fin de la journée, j’ai pris le chemin de Versailles […] et traversé le pont Louis XVI [5]; il était jonché de cadavres d’hommes nus en état de putréfaction en raison de l’intense chaleur. »
La phase démocratique la plus radicale de la Révolution française commence donc par une débauche d’atrocités. Mais toute cette violence ouvre un nouveau monde de possibilités sur le plan politique. Pour la première fois, en effet, depuis Athènes dans la Grèce antique, la démocratie directe devient un but collectif concret, du moins dans l’esprit de ceux qui défilent dans les rues de Paris, armés de mousquets et de piques.
Ce soulèvement mène à la dissolution de l’Assemblée nationale, à la convocation d’une Convention constitutionnelle et à l’exécution publique du roi après un simulacre de procès. La Convention donne à Condorcet le mandat de rédiger la première constitution démocratique au monde. Mais celle-ci ne sera jamais mise en œuvre. Le coup d’État des jacobins force Condorcet à se cacher.
Commence alors le Règne de la terreur, nécessaire, selon Robespierre, pour protéger la démocratie naissante de ses nombreux ennemis. À l’automne de 1793, les conscrits de la nouvelle République, sur ordre de Paris, se lancent à l’assaut de la Vendée et tuent quelque 250 000 hommes, femmes et enfants, innocents pour la plupart. La Révolution fait renaître le concept de démocratie, mais au prix d’une effroyable hécatombe. « Ce dont je suis certain, affirme Edmund Burke, c’est que dans une démocratie, la majorité des citoyens est capable d’exercer sur la minorité les oppressions les plus cruelles. » [6] Au lendemain de la Révolution française, ses craintes sont largement partagées par les conservateurs et soi-disant « libéraux ».
Pour se prémunir contre les soulèvements armés et d’éventuelles « voyoucraties », la constitution américaine est délibérément conçue de manière à donner le pouvoir non pas aux citoyens ordinaires, mais à une « aristocratie naturelle ». Comme l’explique un signataire de la Déclaration d’indépendance, Benjamin Rush : « Tout pouvoir dérive du peuple, mais ce n’est pas lui qui l’exerce. Le peuple n’a le pouvoir entre ses mains que le jour des élections. Après quoi, le pouvoir appartient à ceux qui le gouverne et le peuple ne peut plus l’exercer ni le reprendre, à moins qu’on en fasse un mauvais usage. »
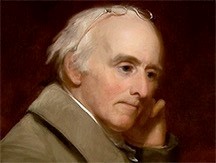
Les États-Unis demeurent une démocratie bien imparfaite, même si son collège électoral vise à contrebalancer l’influence des groupes majoritaires, que son sénat compense les inégalités en matière de représentation politique et que le droit de vote donne lieu à des luttes épiques. Pourtant, le préjugé initial des Américains contre la démocratie s’est transformé presque instantanément après la Révolution française en une ferveur et un grand enthousiasme à l’égard de la démocratie. Parmi les plus fervents adeptes de ce régime, on compte Thomas Jefferson qui, en 1800, a mené son parti démocrate-républicain au pouvoir. Ce faisant, il a fait entrer la démocratie, du moins le mot, dans le vocabulaire américain. Une génération plus tard, Andrew Jackson, le premier grand leader démocrate américain, ou le premier grand démagogue, si l’on utilise l’ancien terme grec, est le premier président plébiscité des États-Unis, qui, selon les prétentions de ses ardents partisans, jouit de prérogatives impériales. N’est-il pas, après tout, le seul représentant élu par l’ensemble des citoyens de la nation, si l’on exclut, évidemment, les femmes, les esclaves et les Amérindiens ? Faut-il rappeler que la démocratie à l’époque de Jackson ne concerne que l’homme blanc ? Jackson a essayé, mais en vain, d’éliminer le collège électoral. Paradoxalement, cette entrave à la démocratie aux États-Unis est une des raisons pour lesquelles ce pays a été le premier à donner naissance au populisme, à la fois au mot et au phénomène. De 1892 à 1896, le People’s Party (le Parti du peuple) a joué un rôle politique majeur dans certaines régions des États-Unis.
À peu près au même moment, Woodrow Wilson, sans doute le plus ardent défenseur de la démocratie du pays, critique le populisme et propose en remplacement une nouvelle façon de concevoir la démocratie. Ce politicologue visionnaire, qui allait devenir le 28e président, a beaucoup réfléchi sur le sens de la démocratie, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Ce régime représente, à ses yeux, le stade le plus élevé de l’évolution humaine. Dans ses journaux privés, il définit « très sommairement » la démocratie moderne comme un « gouvernement de l’opinion publique ». Wilson concède du bout des lèvres qu’en pratique la démocratie implique toujours que « la masse est gouvernée par une minorité de citoyens qui se disciplinent en cherchant à être convaincants, tandis que la masse s’instruit et est gouvernée en se laissant convaincre ». La vision de Wilson, on le voit, est plus proche de « l’aristocratie naturelle » de John Adams que de la souveraineté du peuple pour laquelle les révolutionnaires français et les populistes américains se sont battus. Nous touchons ici à l’ambiguïté fondamentale qui réside au cœur de la démocratie libérale moderne, telle que l’a comprise Wilson. En théorie, en effet, tout le pouvoir provient du peuple, mais en pratique, le véritable véhicule des espoirs d’un peuple est l’élu qui occupe la plus haute fonction lorsqu’il peut compter sur le soutien de « l’opinion publique ». Il n’empêche que l’importance que Wilson accorde à l’opinion publique pose de graves problèmes. Les points de vue peuvent changer rapidement, et même un orateur aussi convaincant que Wilson ne peut jamais être sûr d’avoir convaincu tout le monde une fois pour toutes. Pire encore, comme l’a souligné Walter Lippmann dans son étude phare, Opinion publique (1922), dans une situation politique complexe, où le citoyen moyen dispose seulement de bribes d’informations, il lui est presque impossible de se forger rapidement une opinion claire et cohérente. Lippman a choisi comme épigraphe de son étude l’image de la célèbre caverne de Platon dont les habitants ne voient que les ombres projetées sur les murs et ignorent tout du monde extérieur. La majorité des hommes modernes, pense Lippmann, sont comme ces hommes, prisonniers de présomptions obscures et non vérifiées, préoccupés surtout par leur vie privée et la poursuite de leurs intérêts personnels ; ils ont peu de curiosité pour la chose publique et peu de temps à y consacrer. Lippmann nous livre sa conclusion sans ménagement dans The Phantom Public : « L’individu n’a pas d’opinion sur toutes les affaires publiques. Il ne sait pas comment les diriger. Il ignore ce qui se passe, pourquoi cela se passe et ce qui devrait se passer. Je ne vois pas comment il pourrait le savoir, et il n’y a pas la moindre raison de penser, comme l’ont fait les démocrates mystiques, que de l’agrégation des ignorances individuelles des masses populaires puisse émerger une force directrice continue pour les affaires publiques. » [7]

En 1942, le professeur d’économie de Harvard, Joseph Schumpeter, a bien résumé l’étrange résultat qu’on obtient si l’on combine démocratie libérale de l’opinion publique et méthodes de marketing basées sur la science du comportement. « La volonté que nous observons en analysant les processus est en grande partie fabriquée, et non pas spontanée. » [8] À son époque, les principaux outils de manipulation de l’opinion sont la publicité et la propagande conçues à la suite de sondages. De nos jours, l’intégrité de l’opinion publique est menacée également par le secret entourant de nombreux aspects du processus décisionnel et par le contrôle de plus en plus raffiné de l’information par les spécialistes du comportement et les « capteurs d’attention » (attention merchants), capables d’utiliser les nouvelles technologies pour diriger des messages avec une précision sans précédent vers des publics cibles. Selon Schumpeter le rôle du peuple dans une démocratie libérale est toujours très limité et « consiste à accoucher d’un gouvernement ou, alternativement, d’un organisme intermédiaire qui, à son tour, accouchera d’un pouvoir exécutif national, c’est-à-dire d’un gouvernement. […] La méthode est le système institutionnel, aboutissant à des décisions politiques, dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple » [9]. En d’autres termes, la démocratie moderne n’est pas le règne du peuple souverain « la démocratie est le règne du politicien » [10], d’un individu habile à influencer l’opinion publique et à remporter des élections. Le pouvoir de ce politicien est toutefois contrebalancé par son désir de réélection et par son obligation de quitter ses fonctions pacifiquement s’il est battu. Schumpeter a écrit cela pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a nécessité la mobilisation de toute la population civile dans tous les pays en guerre. À l’échelle mondiale, cette mobilisation a entraîné le massacre sans précédent de soixante millions de personnes, dont une majorité de civils, et de six millions de Juifs. Aux États-Unis, la guerre a entraîné un accroissement spectaculaire des pouvoirs des services administratifs et des Forces armées. Elle a également fait naître la nécessité de garder secrètes les délibérations et les décisions politiques stratégiques. Il n’est pas étonnant, dès lors, que face à cette réalité, Schumpeter n’ait pas été très optimiste quant à l’avenir de la politique. Il craignait que « la démocratie socialiste [deviennent finalement] un trompe-œil davantage encore que la démocratie capitaliste ne l’a jamais été » [11].
Et pourtant, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, tout comme ce fut le cas lors de la Grande Guerre, on a assisté, paradoxalement, à une résurgence de l’idéal démocratique, inspiré par les messages des Alliés, qui répétaient qu’une victoire contribuerait à forger un monde « sécuritaire favorable à la démocratie », comme Wilson le promettait deux générations auparavant. Après les horreurs des deux guerres mondiales, nombreux étaient ceux qui souhaitaient que l’humanité ne revive plus jamais de tels excès violence. Après quelques hésitations et compromis, les vainqueurs ont convenu de créer une nouvelle organisation internationale, les Nations Unies, et ont adopté, en 1948, un nouvel ensemble de principes applicables à l’échelle mondiale, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il est facile de minimiser l’importance d’un document politique qui n’est assorti d’aucun mécanisme contraignant destiné à faire respecter les principes énoncés. Pourtant, le texte de la Déclaration a inspiré la création de mouvements de défense des droits de l’homme, et l’article 21 affirme explicitement que « toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ».
Et c’est ici qu’apparaît toute l’ironie du monde moderne : la démocratie, dans la plupart des régimes existants, qu’ils soient libéraux, socialistes ou nationalistes, est plus ou moins un simulacre de démocratie, et cela, même à l’aune des principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce « simulacre » n’en est pas moins le signe d’une évolution historique : en ce début du XXIe siècle, il n’est possible de gouverner en toute impunité que dans un très petit nombre de pays. Les dirigeants des régimes contemporains qui professent un attachement aux valeurs démocratiques font face périodiquement à la « menace » que représentent les citoyens ordinaires. Bien que mal informés, ces derniers font la queue dans un bureau de scrutin pour exercer leur droit de vote et, s’ils le souhaitent, ils peuvent transférer le pouvoir à un nouveau groupe de politiciens. Comme le dit le professeur d’histoire de Cambridge, John Dunn, « nous vivons dans un monde où la foi, la déférence et même la loyauté ont largement disparu, et la profonde admiration que l’on peut éprouver pour une personne est bien souvent très éphémère ». Voilà, sommairement résumé, l’esprit démocratique moderne. Mais nous vivons aussi dans un monde où l’idéal de la démocratie est plus universellement respecté que jamais et parfois pris très au sérieux, pour le meilleur ou pour le pire. Par exemple, au cours des décennies consécutives à la ratification de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la plupart des présidents et diplomates américains ont poursuivi l’œuvre de Wilson en faisant la promotion de la démocratie libérale partout dans le monde, parfois, il faut le reconnaître, en usant de la menace des armes, alors qu’au même moment, les régimes communistes cherchaient à exporter leur « centralisme démocratique », version aux antipodes de la démocratie libérale.
Nous avons également assisté à l’élection de démagogues capables de faire appel aux pulsions primaires des citoyens ordinaires, et à l’émergence de partis politiques farouchement hostiles aux élites coupées de la réalité, bien que la plupart de ces élites conservent leur mainmise sur le pouvoir et qu’une minorité de super-riches continue à s’enrichir et est plus que jamais protégée des aléas de la vie, ce qui n’est pas le cas de 99 % de la population mondiale. Il ne faut donc pas se surprendre si, dans presque tous les pays du monde, que ces pays soient pauvres ou développés, socialistes ou communistes, autocrates ou libéraux, on assiste à des vagues de soulèvements et de protestations populaires, qui, disons-le, ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Ces simples citoyens se rassemblent pour exiger une répartition plus équitable de la richesse commune et revendiquent pour eux-mêmes une participation accrue au sein d’institutions véritablement démocratiques. Ces mouvements de révolte sont essentiels à la vitalité et à la viabilité de la démocratie moderne. Il y a de bonnes raisons de se méfier du comportement d’un peuple qui tente d’exercer ses droits souverains. Les révoltes démocratiques peuvent donner des résultats désastreux, tout comme les élections. Malgré ces risques évidents, Rousseau et Jefferson n’ont jamais perdu foi dans les citoyens ordinaires. Ils se plaisaient à rappeler cette sage maxime : Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem – « Je préfère la plus orageuse liberté à un assujettissement tranquille. » [12]
____________
Notes
[1] Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie, Paris, Éditeur « De l’Observatoire », 2018, 528 p.
[2] Platon, « La République », dans Œuvres complètes, trad. par Robert Baccou, Paris, Garnier Frères, t. IV, 1938, p. 308. En ligne.
[3] Ibid., p. 219-220.
[4] Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou, De l’éducation, Francfort, [s.n.], 1762, t. I, p. 60. En ligne.
[5] Aussi appelé « pont de la Révolution ». Aujourd’hui, pont de la Concorde.
[6] Edmund Burke, Réflexion sur la révolution de France, nouvelle édition par J.-A. A***, Paris, A. Égron imprimeur, 1823, p. 229. En ligne.
[7] Walter Lippmann, « Le public fantôme. Extrait de The Phantom Public », trad. par Sandrine Lefranc, dans Hermès, no 31, 2001, p. 75. En ligne.
[8] Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme, et démocratie, trad. par Gaël Fain, Paris, Payot, 1951, p. 395.
[9] Ibid., p. 403.
[10] Ibid., p. 423.
[11] Ibid., p. 447.
[12] Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (c1754). Paris, Bordas, coll. « Univers des lettres », 1985, 127 p. Cité d’après l’édition électronique réalisée par Jean-Marie Tremblay, Chicoutimi, 2002, p. 54. En ligne.
James Miller
*James Miller es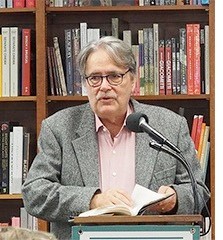
Jean Delisle est traducteur agréé (OTTIAQ), professeur émérite de l’Université d’Ottawa et membre de l’Association humaniste du Québec.
NDLR Les notes à la fin du texte proviennent des recherches de Jean Delisle concernant le texte de James Miller. Les illustrations et leurs légendes proviennent de Claude Braun.

0 commentaires